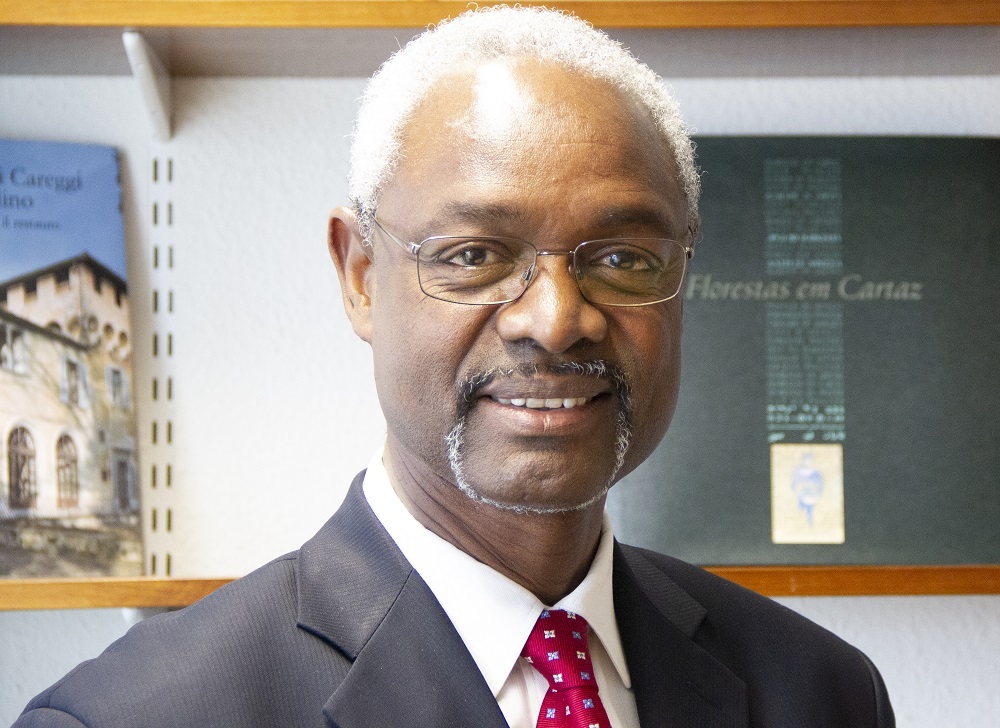ONU Changements climatiques Infos, 26 avril 2019 - S'ils n'étaient pas tant dégradés par les activités humaines, les sols, véritables puits de carbone naturels, pourraient en capter et en stocker davantage. Ils contribueraient ainsi activement à l'effort que nous devons tous fournir pour ne pas dépasser l'objectif de 1,5 °C d'augmentation de la température moyenne mondiale, conformément à l'objectif principal de l'Accord de Paris sur le changement climatique. Solution fondée sur la nature, la restauration des terres produit non seulement des résultats rapides, mais elle est en plus peu coûteuse, crée des emplois et permet aux populations d'assurer leur sécurité alimentaire.
Contrairement à une croyance communément répandue, la désertification ne signifie pas la transformation de la terre en désert. Le terme “désertification” désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, conséquence de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines.
Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), Ibrahim Thiaw a près de 40 années d’expérience dans les domaines du développement durable, de la gouvernance environnementale et de la gestion des ressources naturelles. Il était Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahel avant de prendre la tête début 2019 de la CNULCD, troisième convention issue du Sommet de la Terre de Rio de juin 1992, avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la diversité biologique (CDB). Interview.
Quelle est la mission de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ?
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est le seul traité international qui s'occupe des terres, de la gestion durable des terres. La Terre nourricière : 99,7 % de notre nourriture provient de la Terre. La Terre protectrice : c'est elle qui nous protège contre les désastres naturels, et quand elle est bien protégée elle contribue à notre économie.
On estime que les pertes de terres représentent l’équivalent de 1,3 milliard de dollars par jour du fait de leur dégradation. Or, relativement aux changements climatiques, c'est aussi cette Terre qui est le deuxième réservoir naturel de carbone, après les océans. Donc toute action de conservation des sols, de protection des terres est une action positive pour le climat : à la fois sur l'adaptation mais également sur l'atténuation. Par conséquent, la gestion durable des terres et des espaces nous permet de constituer des puits de carbone supplémentaires. Dans le monde il y a 2 milliards d'hectares de terres potentielles à restaurer qui sont soit légèrement ou sévèrement dégradées, ça veut dire que nous pouvons potentiellement stocker d’importantes quantités de carbone lorsque ces terres seront restaurées.
Pouvez-vous nous expliquer ce lien qui existe entre dégradation des terres, changement climatique et perte de biodiversité ?
Nous avons une planète qui abrite plus de sept milliards d'habitants et bientôt neuf. Cette planète vit et respire : elle inspire et elle expire en fonction du milieu biologique. C'est notre réservoir.
La Convention sur la diversité biologique (CDB) a pour ambition de conserver les ressources biologiques du monde, aussi bien marines que terrestres. La Convention de lutte contre la Désertification (CNULCD) cherche à fixer ces ressources biologiques sur les terres – moins sur la partie maritime – car c’est essentiellement sur la terre que vivent les humains. La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) cherche à protéger l'humanité contre les dégradations dues essentiellement aux émissions de gaz à effet de serre et de gaz à très courte durée de vie dans l'atmosphère, qui ne sont pas concernés par les négociations de climat mais qui sont quand même des gaz nocifs pour le climat.
Ces trois Conventions sont interconnectées. Trois pièces essentielles qui constituent le cœur de l'action de l'humanité comme une espèce de puzzle : il faut que toutes les pièces soient imbriquées. Toute action de protection du climat est bonne pour la biodiversité et pour lutter contre la dégradation des terres. Ces trois conventions ont été négociées à Rio il y a exactement 27 ans et elles constituent un ensemble cohérent.
Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la CNULD
Quel est l’impact de la désertification et des dégradations des terres sur le climat ?
Quand on dit que les terres sont le deuxième réservoir de carbone c'est que toute action de dégradation des terres est émettrice de carbone. Dans les forêts en particulier, il y a de grandes tourbières, beaucoup de carbone y est donc stocké dans le sol, un sol qui est protégé soit par des arbres soit par des espèces végétales éphémères telles que les herbes. C’est pourquoi toute action de dégradation des milieux naturels est émettrice de carbone. A contrario, toute action de restauration et de conservation des terres est un puits de carbone supplémentaire. La connexion climat / dégradations des terres / désertification est donc indéniable.
Bien entendu, il est essentiel de protéger les océans qui constituent les deux tiers de la surface de la planète, et le premier puits de carbone, mais la personne humaine vit sur terre et non sur mer. Et finalement, les terres sont beaucoup plus vulnérables puisqu'il faut nourrir sept milliards d'habitants. De surcroît, la nourriture que nous consommons aujourd'hui n'est pas forcément locale car elle est parfois importée sur des milliers de kilomètres. Nous sommes dans un monde interconnecté et comme je le répète souvent à mes collègues ici : le café que j'ai bu ce matin n'est pas produit à Bonn (siège de la CNULCD, ndlr) !
Quand on parle de protection et de conservation du milieu naturel ce n'est pas forcément une action locale. De la même manière que la protection du climat : c’est un ensemble global. Si on considère ce qu'on appelle « l'effet papillon » cela signifie qu’une action négative quelque part dans le monde peut avoir un impact des milliers de kilomètres plus loin. Par exemple : lorsque la dégradation des terres atteint un niveau extrême on a ce qu'on appelle des tempêtes de sable qui transportent des tonnes de sols sur des milliers de kilomètres. Mais parfois cela peut avoir un effet positif comme lorsque la forêt amazonienne reçoit des nutriments du Sahel et du Sahara, contenus dans le sable du désert car le sable est un fertilisant naturel !
Pouvez-vous nous donner des exemples très concrets de dégradations des terres ?
L'action de dégradation des terres c'est un peu comme les changements climatiques. Ce n'est pas une vague, ce n'est pas une inondation avec une déferlante. Ce sont parfois des petites actions très nocives qui sont menées par un agriculteur, un éleveur ou par un feu de brousse qui constituent une tache, puis ces petites taches se rassemblent parfois pour constituer une grande plaie. L'accroissement de la population urbaine et les modes de consommation non durables de l'humain la nourrissent également. Cette grande plaie se concrétise soit par une perte végétale soit par l'érosion des sols. C'est ça la dégradation des terres. On estime qu’au niveau mondial on a l'équivalent de 23 hectares de terres qui sont perdus chaque minute du fait de la déforestation, de la dégradation des zones humides, des lacs, des rivières, etc. Cela peut être dû à une surexploitation des terres pour l'agriculture, parce que le monde est de plus en plus gourmand, de plus en plus consommateur de produits dont d’ailleurs un tiers sont perdus et ne sont pas consommés : c'est le gaspillage alimentaire. Mais il peut y avoir aussi les pertes après récolte qui dans certains endroits peuvent atteindre jusqu'à 40% de la production ! Une perte simplement parce que le paysan qui produit n'a pas la possibilité de faire arriver son produit au marché par manque de moyens de conservation, dus par exemple à un manque d'énergie : les légumes, les fruits, tous les produits périssables sont extrêmement vulnérables, ou bien parce que les routes ne sont pas bonnes, par conséquent l'accès aux marchés est très difficile ou encore, bien souvent d’ailleurs, le paysan pauvre du Mali ou du Malawi peut transporter son produit jusqu'au marché pour le perdre juste au pied des consommateurs parce qu'il n'a pas pu avoir les boîtes de conservation adéquates pour ses tomates ou ses fruits, donc c’est jeté à la poubelle. Malheureusement, tout ça c'est du carbone. Parce qu'un fruit c'est du carbone, de l'eau, de l'énergie, de l'économie : si on fait le bilan carbone de toute cette production mal ou non consommée ou jetée, c'est finalement une perte énorme pour l'humanité ! Et malheureusement en même temps ça contribue au changement climatique, et aux phénomènes de dégradation de terres et de perte de biodiversité.
Quels sont les pays principalement concernés par ces problèmes de désertification et de dégradation de terres ?
C'est un phénomène global. Toutes les régions du monde sont concernées. Certaines régions sont plus frappées que d'autres bien naturellement : le continent africain, du fait du grand Sahara et du désert du Kalahari est une région fortement frappée par la dégradation des terres. C'est aussi une région où les populations sont économiquement moins nanties et sont donc plus dépendantes des milieux naturels. Il y a très peu d'Africains qui ont un compte bancaire, en revanche ils ont un capital naturel. Donc ce sont des régions très dépendantes d'une couche de sol et de quelques gouttes de pluie pour vivre. Mais l'Asie est tout aussi frappée, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Chine : toutes les régions du monde. L'Europe ! Toute la région méditerranéenne est frappée par les questions de dégradation des terres, des régions de montagne parfois, mais également des plaines du fait de l'activité humaine. L'Amérique latine estime que 40% de ses terres sont dégradées. Ce n'est pas un phénomène local. En outre, cela peut être amplifié par des actions locales pour nourrir une population locale ou du fait de certaines situations comme les accaparements de terres.
Sont également en cause des systèmes, des modes de production et de consommation non durables qui ne sont pas adaptés à la capacité de charge de la planète. On a surpassé la capacité de charge de la Terre. Chaque année vous voyez d’ailleurs des organisations qui calculent le « jour de dépassement » écologique. Le jour ou l’humanité consomme plus de ressources naturelles, émet plus de gaz à effet de serre que la planète n’est en capacité d’en produire ou d’en absorber au cours d’une année. Et chaque année on perd des jours supplémentaires : on a besoin maintenant de deux planètes et bientôt de trois ! Or nous n'en avons qu’une. On est en train de grignoter sur notre capital si bien qu’on a moins d'économies et donc moins de revenus, si vous utilisez encore l'analogie d'un compte bancaire.
Quelle est la stratégie de votre agence pour lutter contre ces phénomènes ?
Premièrement, c’est d’abord la stratégie du garrot pour réduire la saignée, la plaie béante qui fait couler du sang. Il faut arrêter la saignée. Réduire les pertes de terres. Revoir nos modes de consommation et de production pour l’arrêter et essayer ensuite de soigner la plaie en restaurant les milieux naturels dégradés.
Deuxièmement, et c’est la bonne nouvelle : ces actions de restauration sont de magnifiques pourvoyeurs d'emplois, de millions d'emplois, parce que ce sont des activités à haute intensité de main d'œuvre. Tandis qu'on réduit les changements climatiques, on conserve la biodiversité et on protège la Terre, donc c'est du gagnant gagnant. Cette action de restauration des terres se traduira soit par de nouvelles terres disponibles pour l'agriculture, pour le pastoralisme ou pour les activités touristiques : donc en régénérant les terres on génère des revenus à long terme. Par conséquent, ce n'est pas seulement de l'emploi à court terme pour fixer, pour restaurer le milieu, mais c’est également pour générer une nouvelle économie à long terme.
Troisièmement, et c’est aussi une bonne nouvelle : en menant ces activités de restauration du milieu naturel dans des zones dégradées, on aide à remonter l'économie vers le haut, et de ce fait on réduit les risques d'immigration irrégulière ou d'immigration forcée. Il y a beaucoup de jeunes qui sont forcés de quitter leur milieu parce qu'il n’y a plus de production. Ils vont donc vers la ville voisine ou vers le pays voisin et de plus en plus loin…
Donc restaurer le milieu naturel est une excellente manière de donner les moyens aux populations de rester dans leurs territoires, surtout les jeunes, et de réduire cette perte humaine extraordinaire de jeunes qui vont mourir parfois sur le chemin d'une immigration de plus en plus chaotique et de plus en plus périlleuse.
Comment concrètement la CNULD accompagne-t-elle les populations ?
En tant que Convention, nous aidons les États à établir des politiques adaptées, à revoir le concept de développement, mais nous aidons également nos États membres, nos États Parties, à développer des programmes. La structure du « Mécanisme mondial » au sein de la convention fait de la CNULCD une institution unique par rapport aux deux autres conventions de Rio. Elle a pour ambition et pour mandat d'apporter un appui technique aux États pour développer des programmes, des politiques, aider dans la recherche de financements... mais nous ne faisons pas de mise en œuvre. La mise en œuvre se fait par les États eux-mêmes, les ONG, par les institutions et les autorités locales, les élus locaux etc. ou par une assistance internationale telle que celle que peut apporter les Nations unies. C’est également un travail d'accompagnement, de soutien, afin de les aider à avoir accès aux fonds globaux, mais surtout pour les aider à développer leur propre politique de développement, avec leur propre budget, pour inverser la tendance, pour véritablement valoriser leur propre capital.
Faudrait-il davantage intégrer la réhabilitation des terres dégradées et la désertification dans les discussions climatiques internationales ?
Oui c'est absolument essentiel. C'est déjà le cas d'une manière indirecte quand on parle des forêts parce que les forêts sont assez présentes dans les négociations climat. Mais c’est vu simplement sous l’angle des « forêts tropicales ». Donc il faudrait élargir cette discussion puisque, comme on l'a dit, s’il y a jusqu'à 40 % de la surface de la Terre qui est frappée par la désertification et la dégradation des terres, cela veut dire qu'il existe potentiellement un espace de stockage énorme dans lequel on peut stocker du carbone - il y a déjà du carbone dans les zones de savane etc. - mais on pourrait stocker encore davantage de carbone.
Dès lors qu’on restaure les espaces dégradés, cela induit d’autant moins de pression sur les forêts, puisqu'on redistribue l'activité humaine sur une zone beaucoup plus large. C’est pourquoi il est absolument essentiel que dans les négociations climatiques, on intègre les éléments liés aux zones forestières ouvertes, aux espaces plus ouverts que les zones et forêts humides denses, qui font l'objet de discussions dans le cadre des programmes REDD+ par exemple. D’ailleurs, il faudrait autant travailler sur la conservation des mangroves qui sont dans les zones côtières.
Alors oui, c’est un phénomène qui est intégré, et les négociations sont bien sûr séparées parce qu'on a trois conventions, mais les activités doivent être complètement intégrées. Ce sont les mêmes États, les mêmes Parties, les mêmes peuples ! C'est la même planète donc on ne peut pas avoir des œillères, il faut absolument qu'on puisse travailler de manière synergétique.